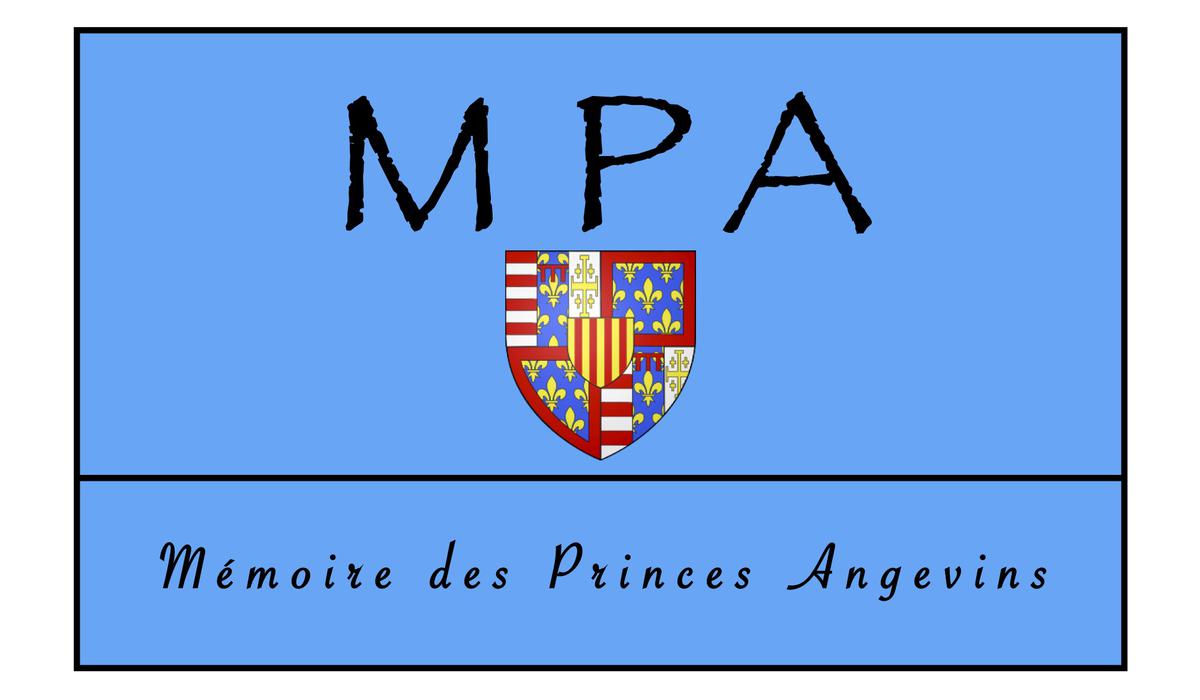Valter Leonardo Puccetti,
Charles Martel d’Anjou et Dante
Texte intégral 
11. La présence de personnages de la maison d’Anjou dans la Divine Comédie est imposante, par le nombre de citations et d’épisodes qui les concerne, et presque toujours négative dans le jugement de Dante. Il faut rappeler, d’une façon générale, que Charles Ier avait eu l’apanage de l’Anjou et du Maine par son frère Louis IX, le saint, en même temps qu’il devenait comte de Provence et de Forcalquier en 1246, en vertu de son mariage avec Béatrice, fille de Raymond Bérenger IV, mort l’année précédente et resté sans héritier masculin. Charles d’Anjou est appelé en Italie par le pape Clément IV, pour réaffirmer les droits de l’Église sur le royaume de Sicile, après avoir excommunié Manfred, fils naturel du grand Fréderic II qui se proclamait héritier de l’Empire. Dans l’Italie du centre et du nord, d’ailleurs, le parti gibelin, le parti impérial, a le dessus, à ce moment-là, et le pape craint d’être pris dans un étau . De plus, il y a tout intérêt à ce que l’essor de la civilisation des villes, en Italie, ne soit pas étouffé par la vieille féodalité de marque impériale, parce que l’activité et l’esprit d’entreprise, et donc la liberté des marchands et des banquiers italiens, qui soutiennent le parti guelfe, le parti de l’Église, sont vitaux pour l’économie européenne en général. La descente de Charles d’Anjou en Italie prend toutes les formes d’une croisade, et Manfred est l’Antéchrist : la propagande guelfe lui attribue des caractères démoniaques, son ouverture au monde arabe, qui avait été aussi celle de son père, est lue comme une reniement de la foi chrétienne. Son charme personnel lui vaut l’accusation de tenir un harem à la manière des infidèles, sa naissance illégitime est enveloppée de légendes sulfureuses. À son arrivée, Charles est salué par le parti guelfe comme un héros d’épopée, l’onomastique même est pliée à ce message ; Charles est la réincarnation d’un plus grand Charles, de Charlemagne qui, lui aussi, pour défendre l’Église des menaces et des vexations d’autres germaniques (les Lombards), était venu dans la Péninsule en libérateur. La figure de Charles est d’ailleurs entourée d’attraits romanesques : trouvère, arbitre de jeu-partis, amant des tournois, dans les deux nouvelles italiennes, très belles nouvelles d’ailleurs, où il est protagoniste, l’une contenue dans un recueil anonyme de la fin du treizième siècle, le Novellino, l’autre placée dans le Décameron de Boccace, pour lui il est toujours question de conquêtes amoureuses, dans les deux cas singulièrement ratées, mais dans le premier cas s’affirme son astuce, dans le second sa force d’âme. La victoire sur Manfred, à Benevent en 1266, bataille où son rival meurt, le laisse maître du jeu et dans les sept ans qui suivront il imposera la suprématie du parti guelfe dans toute l’Italie. Or, comme Dante était guelfe, d’une famille qui avait subi l’exil imposé par les gibelins dans les années de pouvoir gibelin à Florence, quel était le problème, se demandera-t-on ? Pour le faire comprendre et, en général, pour faire comprendre la position de Dante et la déception d’une partie même du monde guelfe envers la famille angevine et envers les Capétiens, je me concentrerai sur le chant VIII du Paradis de Dante, un des plus beaux du poème, un chant entièrement construit autour d’un personnage, Charles Martel d’Anjou, qui paraît façonné sur le modèle du Marcellus de Virgile, dans le sixième chant de l’Enéide : le jeune prince mort avant l’heure, ante diem, le prince qui aurait pu changer le monde, la fleur de toutes les vertus. Déjà le nom de Charles Martel répondait encore à la volonté angevine de se présenter comme en continuation de l’oeuvre carolingienne, comme les auteurs d’une translatio imperii face aux Hohenstaufen : Charles Martel était en effet le nom du grand vainqueur de Poitiers contre les Sarrasins, le nom du chef de la dynastie glorieuse, le grand-père de Charlemagne. Charles Martel était le petit-fils de Charles I, le fils de Charles II le Boiteux, il mourra en 1295 à 24 ans, héritier désigné du trône de Sicile et dejà titulaire, depuis 1292, de celui de Hongrie par volonté du pape et par droit maternel (sa mère était Marie de Hongrie, soeur de Ladislas IV, resté sans descendance masculine). Cet angevin apparaît à Dante dans le troisième ciel, celui de Vénus, c’est-à-dire celui des âmes qui ont su sublimer un amour terrestre et le convertir en amour divin. Dante, tout comme la Chrétienté de son temps, croit en l’influence des astres sur les aptitudes humaines, tout en sauvant le libre arbitre. À vrai dire toutes les âmes du paradis résident dans l’Empyrée, qui est le ciel au-delà de tous les cieux, un lieu non-lieu de l’esprit, le ciel immatériel, mais puisque Dante fait son voyage en chair et en os, avec son corps et donc avec tous les défauts de la matière, les béatitudes aussi doivent lui apparaître dans la matérialité des corps célestes, selon le principe aristotélitien et puis thomiste que l’homme peut apprendre seulement par les sens ce qui est ensuite objet de spéculation intellectuelle. Vénus est, après la Lune et Mercure, le dernier ciel où la condition de béatitude n’est qu’une conversion, qu’une élévation d’un appétit terrestre et non pas le triomphe de ce qui était déjà sur terre la plénitude d’un destin de sainteté. Selon l’astronomie ptolémaïque le cône d’ombre de la terre projeté par le soleil a sa pointe juste sur Vénus : donc, selon l’interprétation morale qu’on en donnait, les trois planètes sous ombre (pour les anciens la lune est une planète) tenaient en quelque mesure du terrestre, de la sphère inférieure, dans les impulsions qu’ils dégageaient au moment de la conception des créatures. Mais l’inclusion de Charles Martel dans ce groupe d’esprits pose quelque problème. Pour l’entendre il faut savoir que, dans le chant suivant, toujours au ciel de Vénus, on rencontre : Folquet de Marseille qui, avant de devenir évêque, fut grand troubadour et homme aux amours à scandale ; Cunizza da Romano, grande dame avec une histoire déshonorante de fuite amoureuse avec un autre troubadour, devenue dévote dans sa vieillesse démunie ; Rahab, la prostituée de la Bible qui aida, au péril de sa vie, des espions juifs à s’introduire dans Jéricho pour la conquérir. On le voit, ce sont des exemples de luxure purgée, des avatars de Marie Madeleine. Mais rien de ce qu’on sait de la vie brève de Charles Martel n’autorise à le ranger dans cette typologie. Lisons le texte, que j’offre traduit pour la Pléiade par André Pézard, un des plus grands dantologues du XXe siècle, bien que sa traduction de la Divine Comédie se complaise d’archaïsmes qui voudraient être évocatifs mais qui sont parfois lourds et obscurcissent le sens souvent patent de l’original.
22. « Il [Charles Martel à Dante] me dit : “Je hantai votre bas-monde, / Brève saison ; si plus longue eût été, / Moult y aura de mal, qui n’aviendrait. / Je suis à toi celé par cette joie / Qui entour moi rayante [c’est-à-dire « rayonnante autour de moi » : je traduis Pézard qui traduit Dante…] me dérobe / Comme le ver que sa soie enveloppe » (v. 49-54). L’âme de Charles Martel est totalement enrobée par la lumière qui empêche de reconnaître quoi que ce soit des traits qu’il avait sur terre. Cette lumière n’est autre que sa béatitude, elle est « letizia », joie qui éclaire, visibilité de la transcendance intérieure. La comparaison est avec le ver de soie : comme Dante avait écrit ailleurs, exactement dans le Purgatoire, le papillon angélique attend de sortir, quand nous sommes ici-bas sur terre, de son enveloppe larvaire : pour Charles Martel l’attente se situe à un degré supérieur et ne prendra fin qu’à la fin des temps. Tout le paradis dantesque est un défi à l’ineffable, une joute de métaphores qui essaient l’approximation à une vision qui dépasse tout instrument humain du langage. Le début du discours est pourtant mélancolique, de ce gentil prince français qui n’a jamais connu la France et même qui n’a jamais franchi, je ne dis pas les Alpes, mais les Apennins. Un prince aujourd’hui oublié en France et qui vit, dans une splendeur isolée, dans la poésie de Dante : j’avoue naïvement que j’ai toujours été étonné que Charles Martel trouve sa place dans le monumental Dizionario Biografico degli Italiani, le dictionnaire biographique des Italiens, publié par l’Académie d’Italie… Dans le texte original un enjambement, figure dont Dante est maître inégalable, coupe le verbe au passé (« m’ebbe » = m’eut) du séjour sur terre, quasi un mauvais rêve pour le prince qui est maintenant humble vassal dans le royaume de Dieu. Et puis, au vers 51, les accents, deux fois sur deux mots-clés, le futur prophétique : « sarà » ( = sera) et « mal », qui porte l’accent principal du vers et qui est juste avant la césure, pour plus d’effet, et enfin l’allittération « molto/mal », font résonner la note sinistre de la ruine que la mort du prince a portée aux vivants. Tout le discours de Charles Martel, comme nous le verrons, semble construit sur le modèle du planh provençal, de la chanson pour la mort du seigneur (par exemple Dante connaissait et admirait les deux de Bertran de Born à la mémoire du jeune roi Jeune, Henri d’Angleterre : la première oeuvre latine écrite par Dante dans l’exil, le De vulgari eloquentia, c’est-à-dire L’éloquence en vulgaire, est, pour moitié, une analyse critique et métrique de la poésie des troubadours en langue d’oc et des poètes italiens qui l’ont précédée), se lamentant comme tous les planh de la perte de largueza, de munificence avec la disparition du seigneur qui est, dans les planh, toujours régulièrement le dernier des bons seigneurs, mais un planh, celui du prince angevin, une complainte paradoxalement composée et récitée par le défunt. La participation des esprits dans l’outretombe dantesque aux problèmes qui hantent les hommes sur terre, aux sorts de l’humanité, qu’il y ait pour ainsi dire un engagement politique dans l’au-delà, ne doit pas surprendre : Hegel déjà, dans son cours d’esthétique, remarquait que l’humanité des personnages de Dante est renforcée par l’éternité et non oblitérée par elle, non désincarnée, et que si les âmes infernales continuent de regarder la terre, c’est parce qu’elles n’ont jamais su se libérer de la dimension terrestre et que c’est pour cela qu’elles sont condamnées, tandis que pour les âmes sauvées la charité est le moteur de leur souci pour nous. La connaissance de l’avenir, de la part des saints, n’est pas exempte d’anxiété. La paix lumineuse est leur vision de Dieu ; c’est la paix pour eux-mêmes devant Lui qui leur a apporté le pardon, mais tant qu’il y aura histoire, c’est-à-dire tant qu’on ne sera pas arrivé à la fin des temps, leur regard sur nous, selon Dante, portera les traces de leur humanité participative.
33. Continuons la lecture : « Fort m’aimas-tu, et ce fut à raison ; / Car si j’eusse vécu, de mon amour, / Je te montrais plus que la verte feuille » (v. 55-57). Vers surprenants ! Donc Dante avait connu Charles Martel et il avait été lié avec lui d’une noble amitié ? Charles Martel séjourna quinze jours à Florence au printemps de 1294 pour aller au devant de son père Charles II qui revenait après cinq ans de séjour en France et dans le comté d’Arles dont il était seigneur, comme j’ai dit. Le jeune prince fut accueilli par des fêtes mémorables : les Anjou étaient les chefs du parti guelfe depuis la descente de Charles Ier et le très beau prince, imberbe à vingt-trois ans et comparé à un chérubin par un chroniqueur, entra dans Florence avec une suite féérique, deux cent jeunes chevaliers français et provençaux, aux éperons d’or et aux couleurs de la Hongrie, dont Charles Martel était le roi sans terre, puisqu’il n’était pas reconnu par la plupart de ses sujets virtuels qui reconnaissaient un descendant des Arpad, et qu’il n’était jamais parti occuper son royaume. La ville de Florence, nous raconte encore le grand chroniqueur florentin Giovanni Villani, ami et voisin de Dante, chargea un groupe de jeunes gens, en qualité de demoiseaux, de faire les honneurs de la ville à Charles Martel : le prince courtois aurait reconnu en Dante, l’un de ces jeunes ayant une âme supérieure et semblable à lui ? Le fait que Charles Martel, dans un passage du chant que j’ai omis, fasse allusion à une chanson de Dante, « Voi che intendendo il terzo ciel movete », a poussé à croire que l’entente entre les deux jeunes hommes, c’est-à-dire une grande sympathie humaine, ait pu avoir comme base l’amour de la poésie : mais rien ne nous est parvenu, d’aucune source, sur les délectations poétiques de Charles Martel, sur son amour pour la littérature et pour l’art, ni non plus sur une pratique poétique de sa part. Deux critiques récents élucubrent que les mots de Charles Martel, en considération du fait que nous nous trouvons dans le ciel de Vénus, seraient le témoignage d’un amour homosexuel avec Dante : pourtant Dante condamne les sodomites, dans son Enfer, parmi les violents contre Dieu parce que violents contre la nature, et dans le cercle des sodomites trouve place son propre et très cher maître, Brunetto Latini, qui fut par ailleurs notaire à la cour de France et auteur d’un traité encyclopédique, Le livre dou trésor, écrit en langue française. « Amore », amour, est, ici, très clairement utilisé dans le sens d’amitié. Il n’est pas invraisemblable, d’ailleurs, que Dante ait voulu se vanter d’une accointance qu’il n’eut pas avec le prince. D’abord en 1294 à Florence est en vigueur depuis un an une constitution anti-magnats, une constitution qui exclut les familles de la noblesse féodale urbanisée de toute participation à la vie politique. C’est une constitution quasi-révolutionnaire voulue par une sorte de Gracchus, Giano della Bella, d’origine par ailleurs nobilissime, et qui fut violemment contestée par la papauté au point que, deux ans après, elle fut abrogée et que Giano della Bella fut contraint à l’exil, justement en France, là où il avait passé sa jeunesse et probablement financé, avec d’autres familles de riches marchands florentins guelfes exilés par les gibelins, l’expédition de Charles Ier d’Anjou. Or, Dante était issu de la petite noblesse appauvrie, le père exerça même l’usure à la petite semaine, ce qui fut jeté à la figure de Dante par un ami et poète, Forese Donati, lors d’une tençon en vers : il ne pouvait donc pas être parmi les jeunes Florentins qui entourèrent Charles Martel à Florence à cause de sa naissance, vu la constitution de Giano della Bella, mais si vraiment, compte tenu de l’hôte prestigieux, on avait voulu réserver au prince l’accompagnement de nobles gens seulement, il est extrêmement douteux qu’un petit noble déchu comme Dante ait put être choisi pour cet office. N’importe, ce qui compte est que le poète ait imaginé cette vérité, ait conçu le rêve d’une collaboration entre la poésie et la Grande Histoire ou, si l’on veut, comme l’on dirait aujourd’hui, la Grande Politique. Une utopie irréalisable, brisée par la mort du nouveau Marcellus, et invérifiable pour ce qui concerne la véridicité de sa base biographique. Qu’on remarque finalement, pour ce groupe de vers, la métaphore végétale, qui est obsédante pour tous les passages où les Anjou ou les Capétiens sont cités par Dante. La verte feuille de Charles Martel, tout de même, était destinée à périr précocement, la mauvaise herbe capétienne, dira ailleurs Dante, ne meurt jamais.
44. Nous voilà maintenant au passage le plus lyrique, vraiment très beau, du discours du prince, un lieu difficile à rendre en traduction dans toutes ses nuances et que Pézard déforme un peu en cherchant une sublimité plutôt tarabiscotée : « Pour leur seigneur m’attendez à mon tour / Les bords que baigne à senestre [c’est-à-dire à gauche] le Rhône/ Après que dans son flot Sorgue est mêlée ; / Et la corne de Pouille, enchastelée [c’est-à-dire, qui a comme forteresses] / De Bar et de Gaète et de Catone, / Jusqu’où Verd et Tronte [les deux fleuves qui, l’un du côté de la mer Tyrrhénienne et l’autre du côté de l’Adriatique, marquaient les frontières au nord du Règne de Sicile] en mer dégorgent. / Jà reluisait sur mon front la couronne / De ce pays qu’arrose le Danube [c’est-à-dire la Hongrie] / En délaissant les tyoises [c’est-à-dire « germaniques » : Pézard est allé dénicher cet adjectif dans l’ancien français, inutilement parce que la forme utilisée par Dante est celle encore en usage dans l’italien moderne] contrées / Et Trinacrie [la Sicile, selon le mot grec], l’île belle qu’enfume / Typhéus [le monstre que la mythologie grecque dit avoir attaqué l’Olympe et, foudroyé par Jupiter, était enseveli sous l’Etna, volcan qu’il ferait fumer et érupter avec son souffle] ? Non : mais naissements de soufre / Entre Pelore et Pachyn [les deux caps orientaux, au nord et au sud, du triangle de la Sicile], sur le golfe [de Catania] / Qui de l’Eurus [vent chaud du sud-est, qui vient d’Afrique] reçoit plus âpre noise, / Rendrait hommage à ces vrais rois encore / A travers moi nés de Charles et Rodolphe [l’empereur, dont Charles Martel avait épousé la fille Clémence, mariage politique s’il en fut, combiné par le pape Nicolas III, pour réconcilier les grands ennemis guelfes et gibelins] », et là (v. 58-72) je m’arrête pour le moment, même si je dois couper la période verbale du texte dantesque. C’est comme si Charles Martel se courbait sur une carte géographique, ou qu’il regardait la terre des sommités célestes, et qu’il caressait et qu’il cultivait, dans le souvenir, les domaines dont il ne fut jamais roi. Il n’y a aucune vanité dans tout cela, tout le regret est pour le monde qui a perdu trop tôt son prince, et avec lui une sorte d’âge d’or possible, ce qui reflète le regret de Dante. C’est un moment de pathétique poignant : je ne connais d’autres lieux, de la grande littérature, qui étalent ce thème de la peine du coeur sur la carte géographique, que la troisième élégie du quatrième livre de Properce, que Dante ne connaissait pas, là où Aréthuse suit sur la carte, qu’elle baigne de ses larmes, les itinéraires en Orient de son mari Lycota parti à la guerre dans l’armée d’Auguste. Le passage, ici chez Dante, est constellé de noms de lieux, qui sont savourés avec un goût qu’on dirait pré-proustien : un vers entier est même formé, si on enlève les prépositions, seulement de toponymes, comme des camaïeux, « di Bari, di Gaeta e di Catona », en climax syllabique, villes qui marquent les extrémités des possessions angevines dans l’Italie continentale. Les noms de fleuves ont toutefois la prédominance, le Rhône, le « Rodano », la Sorgue, la « Sorga », le « Tronto », le « Verde » et finalement le Danube, le « Danubio ». Novalis a écrit que les fleuves sont comme les yeux d’un paysage, qu’il sont son trait humain : ici, ils luisent comme un souvenir lointain. Mais une absence importante nous frappera peut-être : pas de citation pour la Loire, pas pour la Maine ! Un prince d’Anjou sans Loire, un prince d’Anjou sans Maine ! Eh bien, avant tout, un prince d’Anjou sans Anjou, parce que deux mois avant que Charles Martel ne meure de la peste, avec le traité d’Anagni conclu par le pape Boniface VIII, un vaste et complexe accord-échange entre les Anjou, les Aragonais et la France faisait que Charles de Valois, frère du roi de France Philippe le Bel ( qui en 1290 avait épousé Marguerite, soeur de Charles Martel) , renonçait à ses prétentions au trône d’Aragon mais obtenait en échange la confirmation de l’apanage de l’Anjou, que Marguerite avait apporté en dot en 1290 et auquel Charles II d’Anjou renonçait, également au nom de son fils, pour d’autres avantages. On remarque d’ailleurs que toute la description paysagiste dantesque est tissée d’éphémère, l’eau qui passe et qui se perd dans la mer, le reflet éblouissant d’une couronne, le vent qui balaie la Sicile, la fumée volcanique : tous des emblèmes du fugitif, de la vanité des espoirs qui se fonde sur terre sur l’inconstance et la faible qualité des hommes. Deux images doivent retenir surtout l’attention, d’abord l’évocation, au vers 64, de la couronne jamais portée : Charles Martel, comme je le disais, fut roi hongrois non reconnu par ses sujets et il fut couronné avec un diadème qui fut forgé pour l’occasion, parce que la couronne sacrée de Saint Etienne était dans les mains des Arpad. Le vers, magnifique, « Fulgìemi già in fronte la corona», grâce à l’accent sur l’antépenultième syllabe du verbe, en hiatus de voyelles en plus (« Fulgìemi ») et grâce aux deux allittérations (« già » avec « -gìemi », deuxième moitié du verbe, « fulgìemi » avec « fronte »), traîne et accompagne l’image de la couronne (« corona ») en enjambement, séparée de sa pertinence, la terre sillonnée par le Danube, comme Charles Martel resta séparé de son royaume resté purement imaginaire. Or, le voyage de Dante est imaginé se passer en l’année topique, de début de siècle, 1300, mais la composition est plus tardive, par exemple on estime que le chant VIII que nous commentons peut avoir été composé autour de 1315/1316 : je le dis parce qu’entretemps une histoire presque caricaturale, touchant à la couronne de Saint Etienne, avait concerné le fils de Charles Martel, Carobert, et je trouve que l’insistance de Dante sur la couronne insaisissable doit trouver des racines aussi dans ces événéments postérieurs. Carobert en 1301 avait hérité des droits paternels sur le royaume de Hongrie et les avait revendiqués sur le champ, en se rendant en Hongrie, après un couronnement, pour lui aussi, accompli avec un diadème occasionnel. Une fois reconnu par la plupart des seigneurs et, comme on dirait aujourd’hui, des nationalités de son royaume, il lui resta à vaincre les dernières mais acharnées résistances de barons locaux qui se passaient la couronne de Saint Etienne (sans laquelle il ne pouvait pas y avoir de véritable légitimité de pouvoir) comme un Graal ou, si vous voulez, come un ballon de rugby, que Carobert échoua à intercepter jusqu’en 1310, donc pendant presque dix ans. Quant à la représentation de la Sicile cachée par la fumée de l’Etna, elle est bien insolite : la terre du soleil est obscurcie et l’explication parascientifique, bien que d’ordre naturel (on croyait, pour expliquer les phénomènes volcaniques, que l’air chaud qui rentrait dans le viscères de la terre chauffait le soufre qui en ressortait enflammé), ne dissipe pas l’image fabuleuse et sinistre, pour le lecteur, du monstre Typhéus, qui souffle des flammes, enseveli sous la montagne. Les vers qui suivent nous parleront justement d’un monstre enragé et d’une Sicile par lui arrachée pour toujours aux Anjou, et pas seulement à Charles Martel à cause de sa mort.
55. La suite déclare en effet les dessous de cette image inquiétante de l’île : « Si male seigneurie qui trop afflige / Les peuples asservis n’avait, aux Vespres [il s’agit de la révolte siciliennne du lundi de Pâques 1282 : deux mille Français furent massacrés en une semaine, l’île tomba dans les mains des Aragonais], / Emu Palerme à crier : “ Meurs ! Meurs ! ” » (v. 73-75). A la perte du bon prince s’ajoute la perte d’une partie du royaume, effet à son tour d’une perte fatale de moralité. En trois vers, la « terzina dantesca », le tercet, la strophe de trois hendécasyllabes à rimes alternées qui est une invention de Dante et dans laquelle s’exprime sa rapide puissance de synthèse, on a le grand tableau d’une révolte, d’une fracture historique, d’une maladie du pouvoir qui a noyé tout un monde qui maintenant est à racheter. Quand Dante écrit en effet son poème, la Sicile était définitivement perdue pour les Anjou, mais au moment imaginé pour le voyage dans l’au-delà, 1300 comme j’ai déjà dit, il y avait encore espoir pour les Anjou de la récupérer et les paroles de Charles Martel sonnent donc comme une mise en garde contre sa famille. Je dois reprendre ici mon discours, que j’avais suspendu, sur le grand Charles Ier : la figure de ce frère de Saint Louis est comme un miroir brisé. Le grand chevalier, le mythe des guelfes, celui qui a nourri les anecdotes, auxquelles j’ai fait allusion, avec la magnificence de sa jeunesse, avec quelque concession même à la dissipation (Joinville qui raconte que Saint Louis lui jeta par dessus bord le tableau et les dés, avec lesquels il ne finissait plus de jouer, lors du voyage en mer vers l’Egypte pour la catastrophique croisade dans laquelle Saint Louis fut fait prisonnier : le biographe du roi était présent à la scène), Charles le grand homme de guerre qui avait cassé les reins aux Hohenstaufen, en écrasant Manfred à Benevent et le jeune neveu de Manfred, Conradin, à Tagliacozzo, et qui avait chassé les gibelins de presque tous leurs postes de pouvoir dans l’Italie du centre et du nord, ce même Charles devient un homme dur, un homme de pierre quand il s’assoit et qu’il commence à gouverner. La guerre en Italie fut très coûteuse et le Pape, qui avait appelé, protégé, béni comme un defensor fidei, comme un défenseur de la foi, Charles dans son entreprise, demandait des revenus vassaliques très onéreux (Charles était vassal du Pape en tant que roi de Sicile), ceux que les empereurs n’avaient presque jamais voulu verser à l’Eglise, et les ressources du pays avaient étés surestimées par les Angevins. De plus, le royaume de Sicile était plein de barons qui étaient encore fidèles aux Hohenstaufen (comme la descente de Conradin, deux ans après la mort de son oncle, l’avait prouvé) et qui avaient été gouvernés pendant soixante ans plus avec le charisme, par Frédéric II et par Manfred (certes tous les deux terribles quand ils étaient désobéis), que par un réseau de fonctionnaires étrangers commettant des abus, des abus que l’état d’urgence des premières années de règne empêchaient qu’ils fussent connus ou reconnus comme tels par un souverain qui vivait dans le soupçon permanent, loin de France, obligé à compter sur ses seules forces à cause de la distance avec sa patrie d’origine et avec son comté de Provence, et qui avait à mi-chemin entre la France et son règne un autre champ de bataille, l’Italie au nord de Rome où les gibelins étaient défaits mais encore forts et prêts à relever la tête. Des barons qui avaient trahi Manfred, Charles se méfiait et les absences du roi de son royaume, dans des campagnes anti-gibelines au nord, ou pour des retours en Provence, était compensées par la dureté de ses vicaires. En France son frère Louis avait accepté plus que soutenu une aventure, celle d’Italie, qui lui paraissait inutile sinon futile, une distraction de l’objectif de la croisade ; cette campagne d’ailleurs avait été mal vue par le clergé qui avait dû verser pour elle des annualités de dîmes ; elle n’avait enchanté que les homme d’armes, les petits nobles de la suite de Charles, les hidalgos, pour ainsi dire, qui après la conquête entendaient capitaliser la contribution armée qu’ils avaient donnée au succès. Et il faut dire que l’exécution capitale de Conradin après sa défaite, aspirant empereur de dix-sept ans, reprochée à Charles par le Pape même, scandalisa certains milieux guelfes qui avait crédité comme chef un héros chevaleresque, qui faisait « servise Deu », le service de Dieu (comme Charles lui-même s’exprima dans ses Conseils écrits au neveu Philippe III pour sa candidature à l’Empire), un David, pas un froid Machiavel. Dante même, au chant XX du Purgatoire, avait accusé Charles de cet acte qui entendait simplement débarrasser le terrain de tout descendant des Hohenstaufen et qui est vu par le poète florentin comme un pur et simple assassinat, tel celui de saint Thomas dont il accuse aussi Charles, de façon pour nous surprenante et qu’il est le seul à exprimer à l’époque avec le chroniqueur Giovanni Villani qui, guelfe noir et enthousiaste de Charles et dont le frère avait d’importants intérêts commerciaux en France et dans le règne de Naples, semble vouloir tamiser les rumeurs accusatrices envers Charles en cuisinant une version un peu alambiquée, d’un médecin de la cour qui aurait cru complaire au roi en tuant Thomas avec le poison. La mort de Saint Louis, lors de la croisade de 1270 détournée par Charles vers Tunis pour ses mirages d’expansion dans la Méditerranée, n’augmenta pas la popularité de Charles : le cortège qui accompagnait la translation du coeur du roi-saint traversa toute l’Italie, solennellement, mené par Charles, tout au long d’une année, à travers une funeste série de deuils (entre autres, la mort d’Isabelle d’Aragon, femme du nouveau roi de France, Philippe III, enceinte de cinq mois, et la mort d’un frère cadet de celui-ci) qui eurent leur sommet tragique avec un événement, un crime, qui jeta la honte sur Charles parce qu’il ne sut ou bien plus probablement ne voulut pas le punir. Guy de Montfort, grand capitaine mercenaire de Charles et enfui d’Angleterre, son vicaire de parti guelfe en Toscane (il avait épousé une Aldobrandeschi, de la famille des plus anciens gibelins de Toscane avant la mort de Frédéric II, après laquelle ils tournèrent casaque), apprit, avec son frère Simon, que le neveu du roi d’Angleterre et son cousin Henry se trouvaient à Viterbe, à la suite du cortège funèbre de Saint Louis. Le père de Guy, le grand Simon de Montfort, avait mené la révolte des barons contre Henri III d’Angleterre et il avait été tué à la bataille de Evesham : les fils qui survécurent et s’évadèrent ensuite eurent le malheur de voir le cadavre de leur père dépecé et exhibé membre par membre sur des piques, comme on faisait aux coupables de lèse-majesté, aux félons contre la majesté, aux fauteurs de sécession (en somme, on mettait en pièces ceux qui avait voulu désunir, désagréger). Guy et son frère attrapèrent par les cheveux leur cousin Henri devant l’autel de l’église de Saint Silvestre à Viterbe, tuèrent deux ecclésiastiques qui essayaient d’empêcher l’horreur, tout cela pendant la messe, à la présence du nouveau roi de France Philippe III, de Charles et de je ne sais de combien de cardinaux, parce qu’à Viterbe se tenait au moment même le conclave pour l’élection du nouveau pape. Les deux frères de Montfort traînèrent Henri, qui les suppliait, tout au long de l’église jusqu’à la sortie, sans cesser de le mutiler à coups d’épée, en le mutilant après la mort même de celui auquel ils avaient voulu infliger le massacre exemplaire qui avait été infligé à leur père. Guy et Simon purent s’enfuir, en se réfugiant dans leurs fiefs, sans autre conséquence qu’une excommunication levée après cinq ans, quand Guy put même reprendre son service armé auprès de Charles d’Anjou comme si de rien n’était. Pour un roi défenseur de la foi il y a mieux, il faut en convenir. A partir de 1272, d’ailleurs, le Pape commence à être gêné par l’interprétation, un peu à la Lord protecteur pour ainsi dire, que Charles donnait de son vicariat en Italie du centre-nord et il le lui retire, les gibelins reprennent du souffle, et en 1274 le concile de Lyon semble combler la fracture religieuse avec l’Empire byzantin, ce qui anéantissait les rêves de Charles de revendiquer pour lui, par droit de succession subreptice, le trône de Byzance. Charles paraît assiégé, rapetissé aux yeux des guelfes mêmes : rien ne rabaisse plus qu’une image de mesquin calcul chez un roi, après des promesses de grandeur. Revenons aux Vêpres, ainsi appelées parce que l’étincelle de la révolte, tout de suite transformée en incendie, se produisit à l’entrée de la messe de l’après -midi, à l’église du Saint Esprit de Palerme. C’est une histoire presque caricaturale de et entre peuples latins mais les chroniqueurs sont d’accord sur l’origine banale ou prétexte pour la révolte : sur le parvis un soldat angevin qui avait bu eut la main baladeuse vis à vis d’une femme mariée. Le mari de celle-là vola l’épée au soldat ou sortit son poignard et il le transperça. Les cloches des Vêpres sonnent partout en ville et cela fonctionne comme un appel au soulèvement.Une fois que la nouvelle s’est répandue c’est vite l’hécatombe, qui ne ménage ni les frères dans les couvents ni les femmes siciliennes des Français. Peu de Français arrivent à se sauver avec des bateaux de fortune en passant le détroit de Messine vers le continent. Ceux qui ont essayé de s’échapper en se dissimulant ou en se déguisant sont repérés en leur faisant prononcer ce que depuis la Bible, dans le Livre des Juges, on appelle un shibboleth, un mot de très difficile prononciation pour des étrangers et, à vrai dire, de manière absolument correcte difficile même par un Italien du continent, dans ce cas un mot en dialecte sicilien, « ciciri», « pois chiche», dont la consonne palatalisée compliquée d’un son apical est absente du système phonétique français (c’est comme si le mot « écharpe», par exemple, était prononcée « eciarp»). En Sicile Charles était rarement présent, au contraire des Hohenstaufen de leur temps, la fiscalité était exercée à des niveaux qui par certains historiens sont jugés record, pour l’Europe de l’époque, de plus Charles sousestimait d’un côté les différences sociologiques entre la France et même la Provence, où de toute façon il avait dû s’imposer en une dizaine d’années de répression, et l’Italie où les autonomies locales étaient très fortes et la bourgeoisie de ville une force non institutionnalisable d’en haut ; de l’autre côté il sousestimait aussi la facilité de rapports secrets que les Byzantins pouvaient avoir dans l’île par la mer, pour la déstabiliser politiquement, juste et non par hasard au moment où il s’apprêtait à attaquer l’empire latin. Une polémique chauvine à taux de ridicule assez élevé a opposé, à partir du dix-neuvième siècle jusqu’à la moitié du vingtième, les historiens italiens et les historiens français, les premiers voyant dans la révolte une ébauche, vraiment anachronique, de conscience patriotique populaire, une sorte d’anticipation mélodramatique du Risorgimento, les seconds défendant difficilement la figure de Charles Ier et accusant le pur complot aragonais-byzantin comme si la colère n’était pas dans les rues mais, glacée, dans les palais (pour ce qui concerne les Aragonais il faut savoir que Constance, la fille de Manfred et dernière héritière des Hohenstaufen, s’était mariée avec Pierre III d’Aragon, lequel hésitait à réclamer les droits acquis à travers sa femme sur la Sicile, et en général sur le royaume de Sicile, parce qu’engagé dans la guerre contre les Maures en Espagne). Les Vêpres siciliennes apparaissaient à Dante comme un châtiment divin par les mains du peuple (vraiment rare, au Moyen Age, une semblable, franche exaltation de la révolte populaire, et de la part d’un hobereau de ville comme Dante, en plus) : le vers 75, qui est celui où dans le texte éclate sans préavis la révolte, après l’auxiliaire en enjambement (« avesse »), est bouché par le cri terrible « Mora ! Mora ! » (« Qu’ils meurent, qu’ils meurent », mot d’ordre réellement témoignés par les chroniqueurs) et il est parcouru par la résonnance, come un bruit d’armes, des « r», qui sont roulés en italien (« Palermo », « gridar », « Mora ! Mora ! »).
66. Les Vêpres focalisent le discours de Charles Martel sur le thème de l’avidité, pour Dante le péché capital de l’humanité contemporaine, celui pour lequel, déjà dans le prologue de son poème, il déclare avoir entrepris le chemin de salvation dans l’outretombe, pour lui et pour le monde. L’exemple de Charles, qui perdit la Sicile à cause du défaut de ce que les troubadours appelaient largueza, la largesse, qui leur semblait inséparable de la seigneurie (qui est « mala », « mauvaise » selon Dante dans le cas de Charles I, dont l’âme est pourtant sauvée par Dante dans l’au-delà : il le voit en effet au Purgatoire parmi les princes négligents mais repentis, quoique au Paradis il l’accuse, comme on verra, de deux crimes odieux). Le vice, reproché par tant de troubadours même de la suite de Charles, tel Sordel, semble se transmettre à la descendance comme disent les vers suivants de Dante : « Et si mon frère [Robert, devenu héritier de Charles II, une fois que Charles Martel fut décédé et qui prit le titre à la mort de son père, en 1309] à tels coups sut pourvoir, / Jà fuirait-il, pour n’en être blessé, / L’avare pauvreté de Catalogne [vers dont le sens, du point de vue historique, est très disputé et qu’on analysera ensuite] ; / Car besoin est, de vrai, que lui ou d’autres / Prennent souci d’empêcher sa galée [c’est-à-dire galère, navire] / Chargée à fond d’embarquer plus de charge. / A large aïeul, chiche neveu : son sang / Requerrait pour durer tel baronnage [dans le sens d’ensemble de barons, de grands seigneurs autour du roi] / Qui n’eut pas pour tout soin d’emplir ses coffres» (v. 76-84). Charles Martel, esprit aimant, alors pourquoi ? Parce qu’il a aimé son peuple, parce qu’il concevait une autre idée de la seigneurie et des responsabilités du pouvoir que sa famille, comme on verra que Dante croit. Charles Martel a été deux fois régent du règne de Sicile : la première fois, quand son père fut prisonnier des Aragonais (comme je le dirai tout à l’heure), il était très jeune, les conseillers de son père gouvernèrent à sa place, la deuxième fois, lors d’un long séjour en Provence du père, il eut deux initiatives qui marquent sa personnalité dans les chroniques. D’abord une loi somptuaire, une loi qui limitait sévèrement le luxe et qui frappait essentiellement la noblesse et la riche bourgeoisie, à partir du nombre de convives dans les fêtes jusqu’à la tenue vestimentaire ; presque simultanément, les constitutions de Melfi, qui réordonnaient l’administration, disposaient de contrôles plus sévères sur elle et imposaient des coupes sombres aux dépenses du royaume. Deuxièmement il fit grâce à un noble de L’Aquila, dans les Abruzzes, qui avait mené une sorte de révolte fiscale dans cette ville, et cela contre les ordres de son père Charles II qui venaient de France et contre l’avis du conseil de la couronne, qui voulait l’emprisonner et l’exécuter : l’anecdote du dialogue entre le fier noble rustique et Charles Martel séraphique et bénin est contée dans une chronique italienne en vers de cette ville d’un grand intérêt, sorte d’épopée rimée d’une ville montagnarde écrite par un probable jongleur, Buccio di Ranallo, au milieu du quatorzième siècle, et il s’agit d’un dialogue sanctifiant qui fait penser à celui, courtois et condescendant, entre Dante et le prince angevin dans la Divine Comédie. Robert, le frère de Charles Martel, n’aurait pas appris la leçon négative de son grand-père, dit Dante, ni celle ni de son père, rajoutons-nous, ce Charles II, que Dante appelle ailleurs dans son Paradis, au chant XIX, l’« estropié de Jérusalem» parce qu’il boitait depuis l’enfance et qui était le titulaire du royaume de Jérusalem par voie paternelle quoiqu’il n’occupât jamais la fonction. La définition méprisante semble marquer, avec le typique racisme physique médiéval, la disproportion entre le titre et l’être, mais souligne aussi la résistence que les Anjou opposaient à la croisade au profit d’intérêts égoïstes. Dans son poème et dans ses traités, pour Dante, Charles II est le roi fantôme, chiche et veule, prisonnier pendant cinq ans des Aragonais, même devenu roi en captivité en 1284, en pleine guerre contre Pierre III qui s’était rendu maître de la Sicile. Il fut fait prisonnier honteusement parce que, contre la prescription catégorique de son père, qui était en France, il avait voulu attaquer dans le golfe de Naples, sur un coup de tête, les Aragonais qui avaient la supériorité navale et qui défilaient avec leur flotte en passant et en repassant devant son château, et tomba ainsi dans un traquenard tendu par l’ennemi et notamment par l’amiral sicilien Ruggero di Lauria, qui avait été auparavant un des fidèles des Hohenstaufen. Quand son père, qui malgré ses défauts était l’un des plus grand hommes d’armes de son siècle, eut appris la nouvelle que son fils avait perdu la bataille – et sa flotte – et qu’il avait été fait prisonnier, il fit le célèbre commentaire que « celui qui perd un fou n’a rien perdu». L’allusion, de Charles Martel, à l’avare pauvreté de la Catalogne concerne son frère Robert mais fouette ensuite son père, on le verra, avec deux métaphores codées qui méritent autant d’attention interprétative. Robert, comme Louis et Raymond Bérenger ses frères, grâce à la médiation du Pape avait été échangé comme otage contre leur père, fait prisonnier comme je l’ai dit : il resta sept ans en Catalogne, où il se lia d’amitié avec des nobles du royaume, approfondit son rapport avec la religion (comme c’était déjà le cas pour son père) très marqué par l’empreinte franciscaine et en particulier par le courant spirituel des franciscains, et entra par exemple en contact avec Pierre de Jean Olivi. Ses deux femmes furent aragonaises, Yolande et Sancia, la première pour un mariage qui voulait être résolutif du contentieux avec le roi d’Aragon Jacques II, dont Yolande était la soeur, et qui aurait dû se retirer de l’île, mais tout fut inutile parce que les Siciliens offrirent alors la couronne à un frère de Jacques, Frédéric III ; la deuxième femme était de la branche des Aragonais de Majorque. Qu’est-ce qu’entend là Dante par « avara povertà di Catalogna », avare pauvreté de Catalogne ? Le débat est de longue date et, comme celui sur les Vêpres, a provoqué, dans les temps modernes ( quand encore on attribuait une importance quelconque à la littérature et à la voix des poètes) des polémiques nationalistes amusantes : par exemple, il y a toute une bibliographie, dans le premier quart du vingtième siècle, accumulée par les savants catalans pour défendre l’honneur de la Catalogne à distance de sept siècles et rejeter l’accusation infamante de Dante. « C’est faux, nous ne sommes pas avares, loin de là ! »… Longtemps on a dit que Robert, éduqué chez les Aragonais pendant sa captivité entre onze et dix-huit ans, avait truffé les cadres de son administration de fonctionnaires catalans, et aussi sous l’emprise de sa femme Sancia, de fonctionnaires-tortionnaires, si je puis dire, tortionnaires des biens appartenant aux sujets du roi. Or, un recensement attentif des registres angevins (dont, hélas, une bonne partie a péri sous l’occupation allemande de Naples pendant la dernière guerre : par exemple le seul historien qui ait publié une monographie sur Charles Martel,( Michelangelo Schipa qui eut accès à certains documents aujourd’hui perdus) prouve que le pourcentage n’est pas significatif. En revanche, grand fut le nombre de mercenaires aragonais, les meilleurs soldats d’Europe à l’époque, qui se mirent à la solde de Robert, et catalan fut Diego de la Rath, vaillant capitaine qui fut nomme vicaire en Toscane mais qui se débaucha là-bas, fut renvoyé par les Florentins à l’expéditeur pendant les hostilités contre l’empereur Henri VII et ne donna pas davantage satisfaction quand il fut envoyé en Romagne. J’ai l’impression que Dante ici juge plus du point de vue d’un Florentin qu’avec une connaissance sûre des choses du royaume de Naples : les mercenaires aragonais, dont Diego de la Rath était l’exemple le plus insigne, étaient accusés par les guelfes de faire traîner les opérations de guerre pour allonger la période de riches allocations payées par les villes, d’exercer des abus dans les campagnes et de provoquer l’inimitié de la population à la juste cause. Sur Diego de la Rath nous possédons une nouvelle du Decameron de Bocacce, lequel souvent emprunte à Dante des personnages de la Divine Comédie, parfois en les transformant selon le contexte ou selon une tradition plus fiable ou correspondant davantage aux convenances politiques de son époque (Boccace est né un demi-siècle après Dante) ou bien même plus dans la perspective angevine (Boccace a vécu longtemps à Naples, dans sa jeunesse et dans sa première maturité, gardant un souvenir très affectueux et très admiratif de la cour du roi Robert). Dans la sixième journée du Decameron, celle des bons mots, des belles répliques, le protagoniste est le Catalan en question, Diego de la Rath, peint comme un matamore, un don Juan, et – attention ! – un faussaire, indigne de son rôle. Un jour, dans la rue, il croise à cheval l’évêque de Florence, homme de mauvaise vie, et les deux serrent de près, entre leurs montures, une femme belle et noble, à laquelle ils profèrent en ricanant une grossièreté assez peu dissimulée. La dame ne perd pas son aplomb et, en se dégageant, répond que, même si elle voulait bien, elle voudrait au moins être payée de bonne monnaie, ce qui foudroie et remplit de vergogne le Catalan. L’avidité des mercenaires aragonais qui viennent faire fortune en Italie blesse donc l’image de Robert qui, en 1300, l’année de la vision littéraire de Dante, ne règne pas encore mais est déjà en lien étroit avec le monde aragonais (Diego de la Rath, par exemple, arrive dans le royaume de Sicile peu avant ou peu après 1300), et le frère de Charles Martel, destiné au trône, devrait pour cela, selon Dante, éviter de se charger d’un poids qui est moral, parce que déshonorant pour lui, et financier. La rengaine, que Boccace reprend indirectement avec Diego de la Rath, sur les Angevins faussaires de monnaie, est d’ailleurs répétée par Dante, comme une note basse, tout le long de la Divine Comédie et étendue à Philippe le Bel : il s’agit simplement de la réduction du poids de métal précieux dans l’alliage des monnaies, régulièrement effectuée par les rois angevins et par les rois de France pour alléger la dette de l’état et parfois avec un but inflationniste qui aurait dû galvaniser l’économie. Là Dante, bien qu’hostile à la philosophie marchande du nouveau monde, à ceux qu’il appelle les gens nouveaux et les profits immédiats, « la gente nova e i subiti guadagni », bien que nobliau dépassé par l’Histoire et frustré par un changement qu’il ne comprend pas, qui le marginalise socialement et où les vieux équilibres ont tous sauté, se montre pourtant bien florentin. On avait un jour demandé à Rockfeller combien valait un dollar : il répondit indigné que « One dollar is one dollar ! », un dollar vaut un dollar, comme s’il s’agissait de l’original du mètre qu’on conserve au Bureau International des Poids et Mesures de Sèvres. Pour des banquiers qui prêtaient aux rois (souvent en les faisant chanter : de Charles Ier, auquel les guelfes florentins avaient financé en bonne partie la campagne de conquête, ils avaient réussi à obtenir une position absolument dominante dans le règne de Naples et un nombre d’exemptions fiscales et de juridictions qui faisait crier au scandale aux Vénitiens par exemple, lesquels par ailleurs regardaient de très mauvais oeil les desseins orientaux de Charles envers Byzance), pour des marchands qui sillonnaient l’Europe, la stabilité de la monnaie était une valeur de nature (on a parlé de théologie du florin, la monnaie florentine, dollar de l’époque) et tous ceux qui altéraient cette donnée “naturelle” étaient des faussaires, des pervertisseurs d’un ordre immuable, je dirais d’une loi dorée, si je voulais faire un calembour... En retournant au texte : les vers 79-80, avec l’exposition marquée de « barca » (navire), en fin de vers, cachent probablement une allusion venimeuse à Charles II, roi au moment de la vision dantesque, non encore mort, une allusion à la défaite navale dont j’ai déjà parlé, honteuse pour Charles et où pour la première fois dans l’histoire fut utilisé un commando de nageurs, pour couler à pic les bateaux angevins en ouvrant des voies d’eau dans les quilles, ce qui provoqua par la suite les protestations non seulement des Anjou, mais même du pape, pour la conduite peu chevaleresque de l’ennemi. J’ajoute que la métaphore maritime, par rapport à Charles II, plus explicitement se retrouve au chant XX du Purgatoire, chant que j’ai déjà cité et où Hugues Capet prononce une invective atrocement prophétique contre sa descendance. Charles II y est comparé aux corsaires qui vendent les femmes esclaves, parce qu’il marchanda les noces de sa fille Béatrice avec le marquis d’Este, Azzo VIII de Ferrare, épisode confirmé par la grande chronique ferraraise et alourdi moralement par la mauvaise renommée du marquis Azzo, vieux libidineux accusé par la voix populaire d’avoir couché avec sa marâtre étant jeune et d’avoir fait tuer un rival politique qui l’avait raillé pour cela (chant V du Purgatoire), et par Dante et ses anciens commentateurs d’avoir acheté au frère de celle-ci les faveurs de Ghisolabella Caccianemico, une noble dame de Bologne (chant XVIII de l’Enfer). Qu’on ne s’étonne pas, la Divine Comédie est un lieu de commérages sans égaux dans le panorama médiéval : le plus grand dantologue du vingtième siècle, Gianfranco Contini, avait coutume de dire que le poème de Dante balançait entre les sublimités des cieux et les potins de pharmacie d’une sous-préfecture. La métaphore maritime, comme vous pouvez le lire au vers 93, s’étend au nouveau Pilate, c’est-à-dire à Philippe le Bel, qui comme un pirate entre avec ses voiles dans le temple : l’allusion est à la suppression violente de l’Ordre des Templiers, pour Dante exclusivement motivée par l’avidité qui est expiée dans le cercle du Purgatoire d’où Hugues Capet, prophète post factum, parle à Dante (la vision de Dante, je le répète, est datée de 1300 mais l’oeuvre est écrite dans les vingt ans qui suivent, Dante pour certains événements est donc astucieuement devin du passé), mais le temple fait aussi penser à l’image de l’Apocalypse, des prédateurs phéniciens et alors le temple serait aussi celui de Jérusalem, serait l’Eglise, violée et volée, par Philippe qui s’est emparé d’elle et l’a traînée à Avignon, pour une nouvelle captivité babylonienne. La cohérence subliminale des champs métaphoriques chez Dante n’a pas encore été piochée à fond, on n’a que des études, bien que souvent remarquables, sur des aspects partiels ; il manque quelque chose de complet, fut-ce désinvolte et discutable, come le vieux livre de Caroline Spurgeon sur Shakespeare, qui fut suivi d’un traitement moins naïf par les livres de Wilson Knight. Il nous reste à commenter la dernière « terzina », le dernier tercet pour lequel j’aie ici espace d’analyse. Le vers 82 est interprété par Pézard comme on a commencé à ne plus l’interpréter depuis une dizaine d’années : en effet, comme ses ancêtres n’étaient pas généreux, on ne voit comment Robert pourrait dégénérer. En revanche, que la nature de Robert ait pu, de large qu’elle était au début, devenir mesquine, déviée aussi par la mauvaise influence catalane, come le soutient Dante, que finalement Robert ait pu être un Charles Martel raté, est autre chose et plus convaincante du point de vue du sens. La « milizia », la milice, que Pézard traduit justement par baronnage, serait la compagnie d’hommes d’armes tels que je vous les ai décrits, elle ne serait pas au sens figuré la conduite de gouvernement et elle oblige, pour l’entretenir, à des exactions insupportables. L’image finale de la première partie du discours de Charles Martel est celle de l’avare avec son coffre (« arca » en italien) et correspond à la vision des guelfes italiens déçus, par exemple dans un sonnet de Pietro Faitinelli, un guelfe lucquois qui écrivit une ballade sur la déroute de Montecatini, la dernière grande victoire des gibelins que l’auteur attribue à la lâcheté du roi (inactif aux yeux des guelfes comme lors de la descente de l’empereur Henri VII, qui paraissait si menaçante) qui, lointain, ne se soucierait même pas de la mort de son fils Charles au combat, parce que ce « treccone », comme il l’appelle (« vendeur de fruit et légumes à la sauvette ») ne pense qu’à la « bruna », la « brune » : on dirait une vache, la brune, parce qu’aussi bien en italien qu’en français déjà au Moyen Age on appelait les animaux d’étable par leur couleur pour les distinguer. Eh bien non, la brune est la Tour Brune, la tour du Chateau Neuf de Naples, construite pour Charles Ier, par l’architecte français Pierre de Chaulas à l’imitation du château d’Angers : le château d’Angers est plus beau, plus articulé et plus imposant, celui de Naples s’impose seulement par sa position imprenable sur le golfe... La tour qui donnait vers la mer, la plus isolée, était dite brune parce qu’y était dominante la pierre volcanique avec laquelle elle fut édifiée par rapport au tuffeau, juste comme à Angers où toutefois on avait alterné le calcaire avec le schiste ardoisier, qui est foncé comme la pierre volcanique. Dans la « brune », comme on l’appelait en renchérissant sur le côté mystérieux et ténébreux, on y gardait le trésor du royaume : Robert, comme le Picsou de Disney, devait s’y plonger en se moquant de tout autour de lui, s’il faut le croire…
Bibliographie 
Alighieri D., La Commedia, secondo l’antica vulgata, a cura di G. Petrocchi, Milano, Mondadori, 1965-1967.
Alighieri D., De vulgari eloquentia, a cura di E. Fenzi, con la collaborazione di L. Formisano e F. Montuori, Roma, Salerno, 2012.
Arnaldi G., « La maledizione del sangue e la virtù delle stelle. Angioini e Capetingi nella “Commedia di Dante” », La Cultura, XXX, avril 1992, p. 47-75, et août 1992, p. 185-216.
Asperti S., Carlo d’Angiò e i trovatori : componenti provenzali e angioine nella tradizione manoscritta della lirica trobadorica, Ravenna, Longo, 1995.
Balint H., Gli angioini di Napoli in Ungheria : 1290-1403, versione dall’ungherese di L. Zambra e R. Mosca, Roma, Reale Accademia d’Italia, 1938.
Barbero A., Il mito angioino nella cultura italiana e provenzale fra Duecento e Trecento, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1983.
Boccaccio G., Decameron, introduzione, note e repertorio di cose (e parole) del mondo di A. Quondam, testo critico e nota al testo a cura di M. Fiorilla, schede introduttive e notizia bibliografica di G. Alfano Milano, Rizzoli, BUR, 2013.
Bognini F., « Gli occhi di Ooliba. Una proposta per Purg., XXXXII 148-160 e XXXIII 44-45 », Rivista di Studi Danteschi, VII, janvier-juin 2007, p. 73-103.
Buccio di Ranallo, Cronica, edizione critica e commento a cura di C. De Matteis, Firenze. Edizione del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2008.
Carozzi C., « La victoire de Bénévent et la légitimité de Charles d’Anjou », J. Paviot et J. Verger, Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Age, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, p. 139-145.
Dante, Oeuvres complètes, traduction et commentaires par A. Pézard Paris, Gallimard, 1965.
De Regibus A., « Le contese degli Angioini di Napoli per il trono di Ungheria (1290-1310) », Rivista Storica Italiana, LI, 1934, 264-305.
Del Vento C., « “L’avara povertà di Catalogna” e la “milizia” di Roberto d’Angiò (PD VIII 76-148) », Nuova Rivista di Letteratura italiana, I, juillet-decembre 1998, p. 339-377.
Diacciati S., Popolani e magnati. Società e politica nella Firenze del Duecento, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2011.
Di Francesco A., « L’Ungheria di Dante », V. Placella (dir.), Lectura Dantis 2001, Naples, Università degli Studi “L’Orientale”, 2005, p. 53-64.
Engel P., Kristó G. et Kubinyi A., Histoire de la Hongrie médiévale, tome 2 Des Angevins aux Habsbourgs, Rennes, Presses Universitaire, 2008.
Fallani G., Il canto VIII del Paradiso, Trapani, Edizioni Accademia di Studi « Cielo d’Alcamo », 1956.
Fenzi E., « Tra religione e politica : Dante, il mal di Francia e le “sacrate ossa” dell’esecrato San Luigi (con un excursus su alcuni passi del “Monarchia”) », Studi Danteschi, LXIX, 2004, p. 23-117.
Fuiano M., Carlo I d’Angiò in Italia (Studi e ricerche), Napoli, Liguori, 1974.
Gauthiez P., Le chant XX du Purgatoire, Firenze, Sansoni, 1909.
Lanza A., « Il canto del “seme dolce” e del “seme amaro” : “Paradiso” VIII », Studi Danteschi, LXXIII, 2008, p. 95-136.
Léonard E.G., Les Angevin de Naples, Paris, Presses Universitaire de France, 1954.
Manselli R., « Il canto XX del “Purgatorio” », Nuove letture dantesche, vol. IV, anno di studi 1968-69, Forene, Le Monnier, 1970, p. 307-325.
Muscetta C., Per la poesia italiana. Studi, ritratti, saggi, discorsi. I Da Dante a Leopardi, Rome, Bonacci, 1988, p. 9-36.
M.G. Muzzarelli e A. Campanini, Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna, Rome, Carocci, 2003.
Riccobono M.G., « ‘Portar nel tempio le cupide vele’ », R.E. Guglielmetti (dir.), L’Apocalisse nel Medioevo, Florence, SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2011, p. 555-580.
Rocca L., Il canto VIII del Paradiso, Florence, Sansoni, 1925.
Ruggieri R.M., Dante e gli Angioini, Rome, Casa di Dante, 1982.
Schipa M., Un principe napoletano amico di Dante (Carlomartello d’Angiò), Naples, ITEA, 1926.
Tambling J., « The Violence of Venus : Eroticism in Paradiso », Romanic Review, XC, janvier 2000, p. 93-113.
Tocco F.P., « Bonifacio VIII e Carlo II d’Angiò : analisi di un rapporto politico e umano », Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica, atti del convegno organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il VIIo centenario della morte, Città del Vaticano – Rome, 26-28 aprile 2004, Roma, Istituto Storico per il Medio Evo, 2006, p. 221-237.
Villani G., Nuova cronica, edizione critica a cura di G. Porta,
Parme, Guanda, 20072 [1990].
Walter I. « Carlo Martello », Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 1977, vol. XX.
Zingarelli N., Il canto XX del Purgatorio, Firenze, Sansoni, 1925.